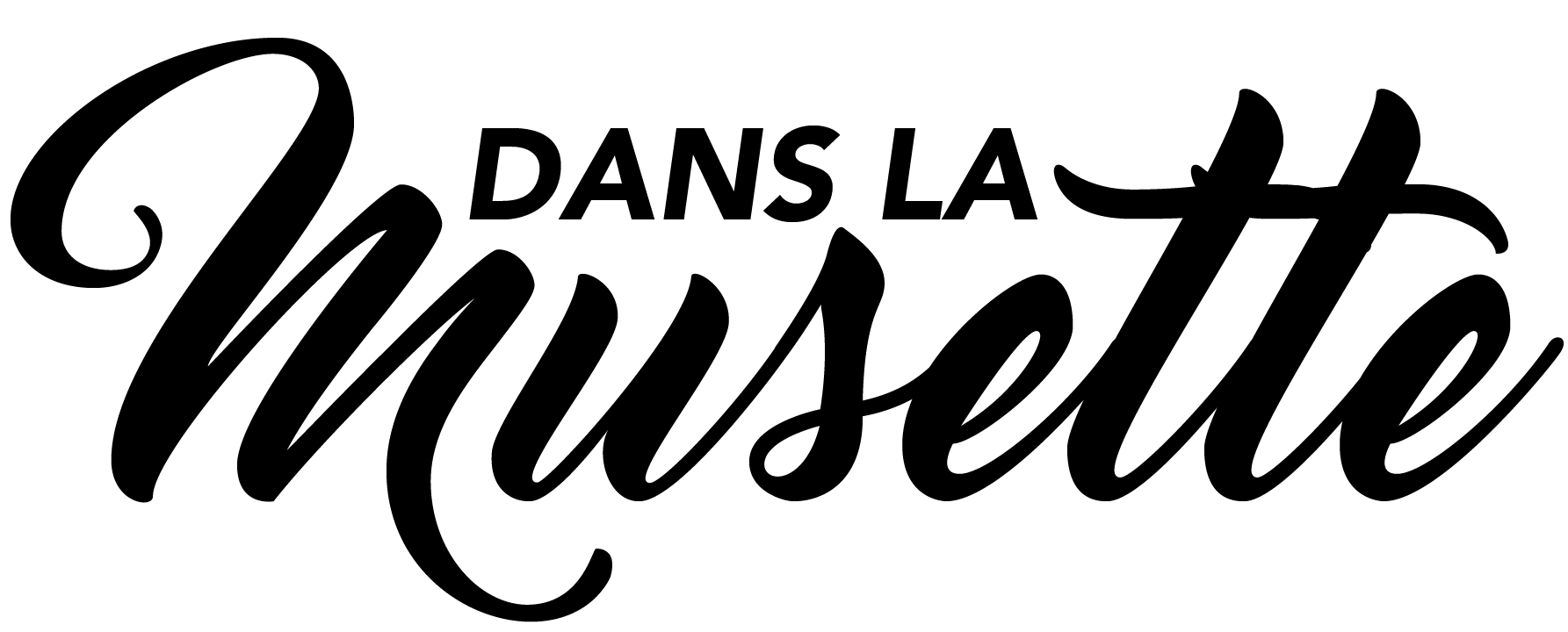Les images (dignes d’un épisode de Walking Dead) de Carlos Betancur la bouche en sang et amoché jusque dans sa chair ont marqué la Vuelta de par leur cruauté et leur violence. Passé à tabac par l’étape, le colombien a réussi à rallier l’arrivée au courage alors que rien ne l’obligeait à le faire. Mais pourquoi les cyclistes sont-ils aussi durs au mal ?
Le cyclisme est un sport des plus exigeants.
Quiconque est déjà monté sur un vélo sait ce que le geste de pédaler à la force de ses jambes implique comme effort et comme souffrance dès lors qu’il faut maintenir une cadence soutenue dans la durée. Grimper un col, en course ou même à l’entrainement, est le summum de la douleur et de la mise à contribution du « dépassement de soi ». Ce terme utilisé à toutes les sauces dans la mythologie sportive est pourtant à prendre au pied de la lettre dans le cadre du cyclisme : ce qu’on demande quotidiennement au coureur, c’est d’aller au-delà de la douleur qu’il ressent déjà. Le sprinteur doit faire exploser ses muscles pour aller plus vite que vite et le grimpeur doit tant bien que mal faire cohabiter la douleur musculaire et l’emballement de son rythme cardiaque… Ce sport est tout simplement l’un des plus exigeants en terme de performance physique pure (avec notamment le triathlon, le demi-fond en athlétisme et globalement tous les sports qui nécessitent de l’endurance et/ou de l’explosivité).
Qu’est-ce que l’endurance ?
« L’endurance est la capacité de maintenir dans le temps un certain niveau d’intensité exigée » nous explique Wikipedia. L’endurance, comme son nom l’indique, c’est « endurer ». Et si l’on se penche sur la définition (du Larousse cette fois-ci) du verbe « endurer » on obtient : « Supporter, subir avec fermeté ou avec résignation quelque chose de pénible, de désagréable ; tolérer ». Rien de bien joyeux, comme vous pouvez le constater (étymologiquement ce verbe est issu du latin « indurare », à savoir « endurcir son corps »). Comprenez que le champ lexical de l’endurance relève plus de la torture que du bien-être.
Les coureurs connaissent la souffrance…
Ce qu’on ne voit pas à la télévision, c’est que le coureur s’entraine quotidiennement à « endurer ». Tous les jours ou presque, son métier est d’aller en baver et de mettre son corps au bord de la rupture pour le préparer à souffrir les jours de course. La souffrance, la douleur, « la tolérance à quelque chose de pénible » sont donc des vieilles compagnes pour chacun des cyclistes. Ils s’y accommodent, par habitude, parce que c’est ce qu’il font tous les jours. Un peu comme le geste pénible au premier abord d’un travail à la chaine à l’usine devient une « habitude » au fil du temps pour celui qui le pratique (on admet néanmoins qu’il n’y a pas la notion de plaisir propre au vélo dans cet exemple et que la comparaison n’a pas tant lieu d’être).
… et savent la maitriser.
Petit à petit et à force de vivre en couple avec elle, les coureurs cyclistes connaissent, comprennent et apprivoisent la souffrance. À un point tel qu’elle devient une vieille amie qu’ils arrivent à canaliser (voire même jusqu’à l’aimer, ou tout du moins à l’accepter avec plaisir ?). Hier, Carlos Betancur est remonté sur son vélo après s’être fracturé la malléole parce qu’il savait ce que « souffrir » veut dire. Il connaissait le sujet sur le bout des doigts et trouvait ça normal de cohabiter avec la douleur. Alors il a fait son métier : il a roulé et terminé l’étape. Il aura fallu une radiographie et des avis de médecin pour le stopper et lui faire comprendre que cette « douleur » était anormale et différente de celle qu’il a l’habitude de ressentir : c’était devenu une blessure à soigner, une douleur avec laquelle aucun homme normalement constitué ne peut vivre. À part un cycliste.